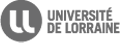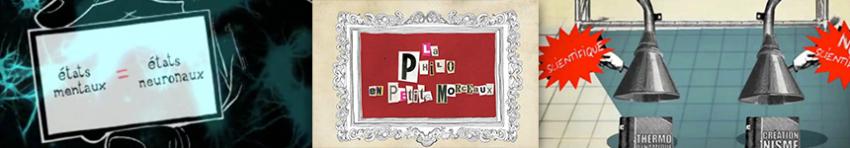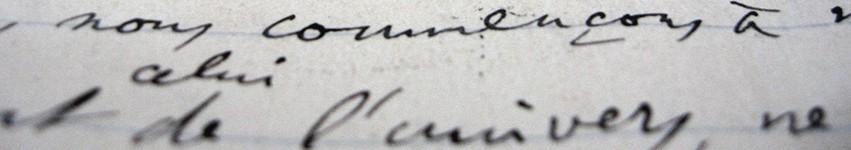Julien Gautier soutiendra le jeudi 14 janvier, 13h, sa thèse intitulée : Le modèle épistémologique Thomas d’Aquin/Jean Calvin d’Alvin Plantinga : approche comparée sur la connaissance naturelle de Dieu. Le jury se compose de :
- Paul Clavier, Professeur à l’Université de Lorraine
- Charles-Éric de Saint Germain, Professeur de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, Nancy
- Thierry-Dominique Humbrecht, Professeur à l’Institut Catholique de Toulouse, co-directeur
- Isabel Iribarren, Professeur à l’Université de Strasbourg, rapporteur
- Cyrille Michon, Professeur à l’Université de Nantes, rapporteur
- Roger Pouivet, Professeur à l’Université de Lorraine, co-directeur
La soutenance aura lieu en ligne.
Résumé :
Le philosophe Alvin Plantinga a concentré sa recherche, depuis les années 1960, sur le problème de la garantie de la croyance religieuse. Il a développé la thèse selon laquelle une personne ne transgresse aucune règle épistémique en affirmant que Dieu existe et que – contrairement à ce qui est communément admis, aussi bien par les penseurs qui rejettent cette existence que par ceux qui l’acceptent – aucune argumentation n’est nécessaire pour avoir le droit d’affirmer rationnellement que Dieu existe. Cette thèse s’inscrit dans une tradition intellectuelle religieuse qui est celle du calvinisme. Plus précisément, Plantinga aspire à clarifier et à affermir des idées développées par le mouvement néocalviniste initié au xixe siècle en Hollande par Abraham Kuyper, et continué par Herman Bavinck.
À l’instar des méthodes scientifiques contemporaines, il propose, pour appuyer sa pensée, un modèle qui ne prétend pas être vrai, mais possible, modèle qui permet de rendre compte de la garantie de la croyance en Dieu. Ce modèle a l’originalité d’associer au réformateur de Genève, Jean Calvin, le théologien et philosophe catholique, Thomas d’Aquin. Le philosophe américain met en avant leurs réflexions communes sur la connaissance naturelle de Dieu, connaissance en quelque sorte instinctive qui, sans avoir à s’appuyer sur le raisonnement, n’est pourtant pas jugé contraire à la raison. L’étude qui suit cherche à éprouver la pertinence de ce modèle Aquinas/Calvin, à voir si la thèse défendue dans Warranted Christian Belief peut effectivement prétendre être un développement d’idées en germe chez ses deux penseurs.
L’œuvre de Plantinga n’étant pas une œuvre d’historien de la philosophie, l’examen de son travail requiert d’abord une bonne compréhension de son modèle : saisir ses caractéristiques, certes, mais surtout comprendre quel problème il entend solutionner et de quelle façon ce problème s’est présenté à l’auteur. Le modèle en effet est l’aboutissement d’une recherche qui porte à la fois sur Dieu et sur le croyant. La question qui est à son origine ne consiste par tant à se demander si Dieu existe ou s’il n’existe pas qu’à s’interroger sur la rationalité de celui qui affirme que Dieu existe. Peut-il l’affirmer rationnellement ou non ? La Reformed Epistemology dont Plantinga est l’un des initiateurs développe une voie originale pour répondre à cette question, une voie qui entend échapper à l’alternative traditionnelle entre théisme et athéisme. C’est dans ce cadre que le modèle a pris naissance.
Alvin Plantinga affirmant que cette voie trouve un fondement dans l’épistémologie religieuse de Thomas et de Calvin, l’examen se poursuit par une présentation systématique de la notion de connaissance naturelle de Dieu chez ces deux auteurs. En effet, un modèle philosophique, s’il n’est pas une reproduction à l’identique de l’original, s’il a même une prétention explicite à le simplifier, doit, s’il veut rester un modèle, nécessairement lui ressembler. L’étude de Thomas et de Calvin a pour but de donner une idée exhaustive de leur compréhension de la connaissance naturelle de Dieu afin de pouvoir juger par la suite de cette ressemblance.
L’étude se termine par une confrontation des sources au modèle. Elle commence par en faire ressortir les traits communs, manifestant ainsi que l’intuition de l’auteur n’est pas sans fondement. Puis, elle développe trois thèmes par rapport auxquels l’idée d’un développement, avancé par Alvin Plantinga, paraît contestable : le lien entre le péché originel et la connaissance naturelle de Dieu, le sensus divinitatis et l’analogie avec le sensible, enfin, la connaissance confuse et la connaissance distincte de Dieu.