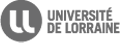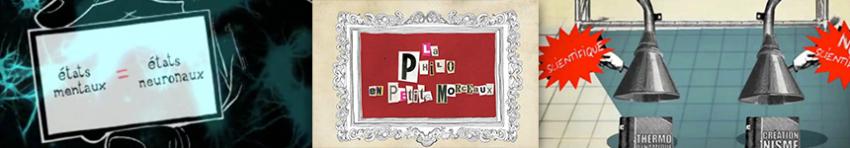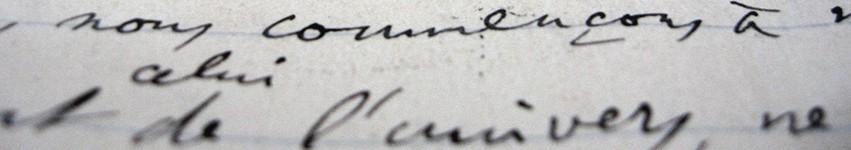Vie du laboratoire
 Nous avons l'immense plaisir d'annoncer que Kai Wehmeier (UC Irvine, à gauche ci-contre) a été sélectionné pour occuper la prestigieuse chaire Fullbright-Tocqueville aux Archives Henri-Poincaré au premier semestre prochain, de début septembre 2025 à fin février 2026. Cette chaire, financée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Programme Fullbright, a pour but de renforcer la recherche collaborative entre les États-Unis et la France. Kai Wehmeier, bien connu à Nancy, où il a été chercheur invité deux fois par le passé, et avec lequel le laboratoire travaille depuis des années (récemment au travers d'un programme conjoint Nancy-Irvine autour de la formalisation, soutenu par le CNRS), est philosophe et logicien. Durant son séjour, il mènera ses recherches à Nancy, assurera des enseignements pour étudiants avancés, et donnera également des conférences pour un public plus large. Nous nous réjouissons de cette excellente nouvelle et vous en reparlerons à la rentrée de septembre.
Nous avons l'immense plaisir d'annoncer que Kai Wehmeier (UC Irvine, à gauche ci-contre) a été sélectionné pour occuper la prestigieuse chaire Fullbright-Tocqueville aux Archives Henri-Poincaré au premier semestre prochain, de début septembre 2025 à fin février 2026. Cette chaire, financée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Programme Fullbright, a pour but de renforcer la recherche collaborative entre les États-Unis et la France. Kai Wehmeier, bien connu à Nancy, où il a été chercheur invité deux fois par le passé, et avec lequel le laboratoire travaille depuis des années (récemment au travers d'un programme conjoint Nancy-Irvine autour de la formalisation, soutenu par le CNRS), est philosophe et logicien. Durant son séjour, il mènera ses recherches à Nancy, assurera des enseignements pour étudiants avancés, et donnera également des conférences pour un public plus large. Nous nous réjouissons de cette excellente nouvelle et vous en reparlerons à la rentrée de septembre.
 Hélène Thomas-Bouther, qui avait occupé le poste de chargée de ressources documentaires à Nancy dans notre laboratoire depuis novembre, a achevé son contrat à la fin du mois d'avril. Nous la remercions chaleureusement pour sa participation enthousiaste à nos activités et son travail très efficace, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite ! C'est Gabriela Torres-Ramos (à droite ci-contre) qui prend sa suite et préside désormais aux destinées de notre bibliothèque. Arrivée le 1er mai en mutation depuis l'INIST, où elle travaillait comme animatrice de communauté DoRANum, Gabriela travaillera également sur certains fonds d'archives. Bienvenue à elle !
Hélène Thomas-Bouther, qui avait occupé le poste de chargée de ressources documentaires à Nancy dans notre laboratoire depuis novembre, a achevé son contrat à la fin du mois d'avril. Nous la remercions chaleureusement pour sa participation enthousiaste à nos activités et son travail très efficace, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite ! C'est Gabriela Torres-Ramos (à droite ci-contre) qui prend sa suite et préside désormais aux destinées de notre bibliothèque. Arrivée le 1er mai en mutation depuis l'INIST, où elle travaillait comme animatrice de communauté DoRANum, Gabriela travaillera également sur certains fonds d'archives. Bienvenue à elle !
Félicitations à Pierre Willaime qui vient d'être élu au Comité de coordination d'Humanistica, l’association francophone des humanités numériques, lors de l'assemblée générale tenue à Dakar, pour un mandat de trois ans (2025-2028) !
Séminaires et groupes de travail
- Séminaire Logiques & philosophie : mardi 6 mai à 14h, Helge Rückert (Univ. Mannheim), "Sincerity (of assertion): Just a question of belief?", Nancy, Campus Lettres et Sciences Humaines, salle J017-018
- Séminaire des Archives Poincaré Strasbourg : mardi 6 mai à 17h15, Gaëlle Le Dref (Archives Henri-Poincaré), "L’éthique des médecins généralistes : entre impératifs de santé publique, déontologie médicale et contraintes sociotechniques”, Strasbourg, 7 rue de l'Université, Bibliothèque
- Grandes conférences des Archives Henri-Poincaré : mercredi 14 mai à 17h, Églantine Schmitt, "La visualisation de données numériques massives, un art du récit visuel", Strasbourg, MISHA, et en ligne [s'inscrire]
- Séminaire Histoire et philosophie des mathématiques de l’Antiquité à l’Âge classique : vendredi 16 mai à 10h30, Tilman Sauer (Johannes Gutenberg Universität Mainz), "How did Leibinz solve the catenary problem?" & David Waszek (ITEM), "Analogies through notations. Leibniz's analogies between powers and differences in light of his drafts", Salle Luc Valentin 464A (4e étage) bâtiment Condorcet, 10 rue Alice Domon et Léonie Duquet, Paris [suivre en ligne]
- Séminaire Objectivité scientifique : mardi 20 mai à 16h, Gaëlle Le Dref (Archives Henri-Poincaré) et Erik Sauleau (Université de Strasbourg), "Objectivité scientifique et santé publique", Strasbourg, MISHA
- Séminaire Codes Sources : jeudi 22 mai à 14h30, Pierre Depaz (NYU Berlin), "Styles de programmateurs et éthiques de programmation", Paris, IRILL, bâtiment Esclangon, 1er étage, plateau SCAI, salle de séminaire
- Séminaires Codes Sources : jeudi 12 juin à 14h30, Stéphanie Mader (CNAM), "Comment et pourquoi lire le code source de jeux vidéo des années 1980 pour analyser leur gameplay ? Cas d’étude sur des jeux vidéo pour SMAKY, une série d’ordinateurs suisses romands", Paris, IRILL, bâtiment Esclangon, 1er étage, plateau SCAI, salle de séminaire
Les vidéos des séminaires sont à retrouver ici : https://videos.ahp-numerique.fr/c/seminaires. Pour les Grandes conférences, c'est là : https://videos.ahp-numerique.fr/c/grandesconferences
Manifestations
- Le modernisme après la "crise", Histoire et actualité du modernisme et de l’anti-modernisme, 5-6 juin 2025, Metz [en savoir plus]
- Journées "Épistémologie comparée des formes de production de l’objectivité scientifique", 15-17 décembre 2025, Strasbourg
Signalons également la troisième édition du Colloque "Drôles d'objets. Un nouvel art de faire", dans le comité d'organisation duquel figure Manuel Rebuschi, et qui se tiendra à Lannion du 2 au 4 juin. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du colloque.
Vous pouvez comme toujours retrouver les vidéos de nos manifestations passées ici : https://videos.ahp-numerique.fr/c/colloques
Hors les murs
- 7 mai, Lorenzo Corti : "La notion contemporaine de justification et la troisième partie du Théétète", Séminaire International de philosophie antique, Université de Bologne
- 16 mai, Anna Zielinska : "Comprendre le social pour apprivoiser le politique : le cinéma israélien face au conflit", Colloque "Penser le rapport entre le social et le politique avec le cinéma", Université Paris Cité, Laboratoire du Changement Social et Politique
- 16 mai, Matthias Dörries : "Contrôler le climat : mise en perspective historique et sociale", Séminaire "La géo-ingénierie solaire : solution ou diversion ?", Programme FORGES, Sorbonne Université, Paris
- 16 mai, Martina Schiavon : "Colaboraciones geodésicas y metrología, entre Francia y Ecuador: la medida de un arco de meridiano en América del Sur (1901-1906)", colloque "Jornadas de Metrología 2025", à l'occasion du 150e anniversaire de la Convention du Mètre, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador
- 19 mai, Céline Fellag Ariouet : "Marie Curie, the BIPM and the radium standards", conférence pour la session d’ouverture de la 24th International Committee for Radionuclide Metrology (ICRM) Conference, Paris
- 20 mai, Lucas Sanzey : " Solidarité et droits fondamentaux dans le droit international : le cas de la Charte Européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne", graduate conference "Ethics & Politics", SciencesPo Paris
- 22 mai, Andrew Arana : "Genealogies of purities”, colloque "Contexualizations in the History of Science. Discussing Mazzotti’s Reactionary Mathematics", Dipartimento di Filosofia, Université de Milan
- 22 mai, Roger Pouivet : "Notes sur la philosophie chrétienne en marge de Roger Vernaux", Colloque "Figures du thomisme au XXe siècle et perspectives du thomisme au XXIe siècle", Institut Catholique de Toulouse
- 2 juin, Gerhard Heinzmann : "Intuition mathématique et formalisation. Un dialogue avec Marco Panza", Colloque en hommage à Marco Panza, IHPST, Paris
- 2 juin, Amirouche Moktefi : "Dodgson and his modern rivals", Séminaire d'Histoire et Philosophie des Mathématiques, SPHERE, Paris
- 2 juin, Andrei Rodin : "Euclid, Lobachevsky, and teaching geometry in the Russian Empire of the early 19th century", Séminaire d'Histoire et Philosophie des Mathématiques, SPHERE, Paris
- 2 juin, Manuel Rebuschi : "Un statut moral pour les robots ? Le détour par l’interaction", Colloque "Drôles d’objets. Un nouvel art de faire", Lannion
- 12-13 juin, Matthias Dörries : "Volcanoes, satellites and the atmosphere in the 1980s", workshop "Greening Satellites", Barcelone
- 14 juin, Anna Zielinska : "Les troubles du stress post-traumatique à l’échelle de communautés. Étude en psychologie politique", Colloque "Formes de vie et relativisme. Perspectives, problèmes et solutions dans l’ontologie sociale contemporaine", ICP, Paris
Sciences - société
 Une actualité très fournie pour Céline Fellag Ariouet ce mois-ci. Après l'exposition "Le Bureau International des Poids et Mesures : 150 ans d’histoire" accueillie par la médiathèque de Sèvres en avril, elle organise une autre exposition intitulée "Robert Doisneau / Raphaël Dallaporta, dialogue photographique", à l’hôtel de ville de Sèvres : l’exposition est présentée à la Mezzanine jusqu'au 31 mai et sur les grilles de l’hôtel de ville jusqu’au 27 septembre. Par ailleurs, elle donnera une conférence le 14 mai à 17h à l’hôtel de ville de Sèvres à l’occasion du 150e anniversaire du Bureau international des poids et mesures et de la sortie de son livre Le Bureau international des poids et mesures, 150 ans de mesures pour le monde (Gallimard), dont nous vous reparlerons dans la prochaine lettre.
Une actualité très fournie pour Céline Fellag Ariouet ce mois-ci. Après l'exposition "Le Bureau International des Poids et Mesures : 150 ans d’histoire" accueillie par la médiathèque de Sèvres en avril, elle organise une autre exposition intitulée "Robert Doisneau / Raphaël Dallaporta, dialogue photographique", à l’hôtel de ville de Sèvres : l’exposition est présentée à la Mezzanine jusqu'au 31 mai et sur les grilles de l’hôtel de ville jusqu’au 27 septembre. Par ailleurs, elle donnera une conférence le 14 mai à 17h à l’hôtel de ville de Sèvres à l’occasion du 150e anniversaire du Bureau international des poids et mesures et de la sortie de son livre Le Bureau international des poids et mesures, 150 ans de mesures pour le monde (Gallimard), dont nous vous reparlerons dans la prochaine lettre.
Catherine Allamel-Raffin interviendra le 6 juin auprès d'enseignants de Sciences de la vie et de la terre dans les locaux du SNES-FSU à Paris, sur le thème : "Que peut-on attendre de l'expérimentation scientifique ?"
Vient de paraître

Christophe Bouriau, Nietzsche théoricien des fictions, Paris : Classiques Garnier, coll. "Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie", 2025. [présentation sur le site de l'éditeur]
* * *
 Georges-Louis Leclerc de Buffon, Oeuvres complètes XIX. Histoire naturelle des oiseaux, tome IV (1778), texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière, Paris : Honoré Champion, 2022. [présentation sur le site de l'éditeur]
Georges-Louis Leclerc de Buffon, Oeuvres complètes XIX. Histoire naturelle des oiseaux, tome IV (1778), texte établi, introduit et annoté par Stéphane Schmitt avec la collaboration de Cédric Crémière, Paris : Honoré Champion, 2022. [présentation sur le site de l'éditeur]
Dans ce quatrième tome de l’Histoire naturelle des oiseaux (1778), comme dans les précédents, Buffon et Guéneau de Montbeillard se répartissent la description des différentes espèces. Il s’agit en outre du premier volume pour lequel Buffon a pu profiter de l’aide d’un nouveau collaborateur, l’abbé Bexon, qui rédige des premiers jets de certains articles. Buffon n’en reste pas moins le maître d’œuvre principal, qui se réserve les morceaux de choix, comme par exemple les chapitres sur les serins, dans lesquels il s’attarde sur les questions d’hybridation qui le passionnent tant elles sont déterminantes pour la définition du concept d’espèce.
Ce tome traite essentiellement de la suite des "petits oiseaux", comme les linottes, bengalis, pinsons, chardonnerets, bruants et bouvreuils, ainsi que de nombreuses espèces exotiques (tangaras, manakins, cotingas), dont certaines sont décrites pour la première fois.
* * *
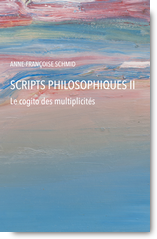 Anne-Françoise Schmid, Scripts philosophiques II. Le cogito des multiplicités, Éditions Chikusido, université américaine de Tokyo, coll. "Studia Philosophica", 2025. [présentation sur le site de l'éditeur]
Anne-Françoise Schmid, Scripts philosophiques II. Le cogito des multiplicités, Éditions Chikusido, université américaine de Tokyo, coll. "Studia Philosophica", 2025. [présentation sur le site de l'éditeur]
Le deuxième tome de l’ouvrage Scripts philosophiques se présente sous la forme d’un lieu de multiplicités philosophiques. Qu’est-ce qui les tient ensemble ? Une fidélité, à la philosophie sans doute, une fidélité au réel surtout. Contempler les philosophies dans leur multiplicité change l’écriture philosophique. La multiplicité fonctionne comme une plateforme, voire un ensemble de plateformes superposées, où il est possible d’extraire des fragments à recomposer autrement. Les concepts sont les voyageurs entre les plateformes et charrient des extraits qui s’adaptent graduellement à leur nouveau lieu.
* * *
- Andrew Arana, "Disagreement About New Axioms in Mathematics", Annals of the Japan Association for Philosophy of Science, 33, 2024, 47-56. https://doi.org/10.4288/jafpos.33.0_47
- Jacopo Bisagni, Isabelle Draelants & Paula Harrison, A Compendium of Early Medieval Science: Studying Isidore of Seville, Computus, and Astronomy in the Age of Charlemagne. Ville de Laon, Bibliothèque Municipale – Bibliothèque patrimoniale, MS 422 – Un compendio de ciencia altomedieval : el estudio de Isidoro de Sevilla, el cómputo y la astronomía en la edad de Carlomagno. Ville de Laon, Bibliothèque Municipale – Bibliothèque patrimoniale, MS 422. [Étude accompagnant le fac-similé du ms. Laon, Bibliothèque municipale, 422], Incipit Manuscript Ediciones, PIAF S.L., 2025. https://www.facsimiles.com/facsimiles/laon-computistical-miscellany
- Adéchina Samson Takpé, Interkulturelle Wandlungsprozesse. Das Beispiel der christlichen Begräbnisfeier in Benin, in Andreas Redtenbacher, Jürgen Riegel (éd.), Liturgie im synodalen Wandel. Ecclesia de Eucharistia auf dem pastoralen Prüfstand, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2025, 101-148.
- Adéchina Samson Takpé, „Das ist auch dein Ort!“ Interkultureller Gottesdienst, in Andreas Redtenbacher, Jürgen Riegel (éd.), Liturgie im synodalen Wandel. Ecclesia de Eucharistia auf dem pastoralen Prüfstand, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2025, 170-173.
Zoom sur ... le projet "La personnalisation des entités naturelles est-elle juste ?", de Christophe Bouriau
Le projet que je viens d'entamer sur les nouvelles fictions juridiques prolonge les enquêtes menées dans l’ouvrage récemment paru, coordonné avec Jochen Sohnle (PR de droit environnemental à Nancy), en collaboration avec plusieurs membres des Archives Poincaré : Rémy Poels, Paul Clavier, Manuel Rebuschi, et Anna Zielinska : Éthique environnementale pour juristes, Mare et Martin, 2024. Il s’inscrit dans l’axe 3 du laboratoire, en lien avec les notions de monde et de normativité. Il questionne la pertinence des nouvelles fictions juridiques, en se posant la question de leur justesse mais aussi de leur caractère juste ou injuste. L’attribution de la personnalité juridique à des entités naturelles (rivières, forêts, montagnes, etc.) consiste à considérer ces éléments naturels et les animaux qui y vivent comme des "sujets de droit", au même titre qu’une personne physique ou morale, comme l’ont bien montré Anna Zielinska et Jochen Sohnle dans notre collectif.  Ce type de fiction, qui vise à mieux protéger la nature en prévoyant des sanctions plus sévères que la sanction pollueur/payeur et en assurant un traitement plus rapide des infractions, peut-il être qualifié de "juste" ?
Ce type de fiction, qui vise à mieux protéger la nature en prévoyant des sanctions plus sévères que la sanction pollueur/payeur et en assurant un traitement plus rapide des infractions, peut-il être qualifié de "juste" ?
On peut interroger le caractère juste ou injuste de l’extension sous deux angles, un angle théorique qui concerne la légitimité de l’assimilation l’une à l’autre de deux entités hétérogènes (une personne et une chose), et un angle pratique, qui concerne la pertinence de la finalité pratique invoquée pour justifier cette fiction ("mieux protéger la nature"), mais aussi la légitimité ou l’illégitimité des sanctions subies par les diverses entreprises (petites, moyennes, grandes) ayant endommagé les sites naturels.
1. La critique philosophique et juridique de l’extension
Au plan philosophique, ce qui est actuellement critiqué par certains philosophes, c’est la tendance de certains pays à rattacher la "fiction juridique de la personnalisation" aux pensées animistes qui assimilent réellement certaines entités naturelles à des personnes. L’extension de la personnalité peut en effet s’inspirer de religions animistes qui considèrent la nature comme une entité vivante avec des droits intrinsèques. On trouve une critique rigoureuse de cette tendance à confondre le plan juridique et le plan religieux sous la plume de Manuel Rebuschi dans l’ouvrage précité.
Une autre objection, formulée par des penseurs d’inspiration kantienne tels que Luc Ferry par exemple, est qu’on dévalorise la notion de personne morale en l’attribuant effectivement à des entités naturelles non humaines. Kant a fixé le sens du terme en nommant "personne" tout être possédant conscience et liberté de choix. Au contraire, le concept de "chose" regroupe chez Kant tous les êtres dépourvus de libre arbitre, c’est-à-dire tout ce qui, sur terre, n’appartient pas à l’espèce humaine.
Si on suit la ligne de pensée de Luc Ferry, il ne faut jamais remettre en cause la distinction kantienne entre les personnes et les choses, même en raisonnant de manière fictionnelle. En effet, si on accepte que des choses soient considérées juridiquement comme des personnes, alors on peut très bien imaginer l’inverse, sous un régime fasciste par exemple, à savoir qu’un groupe de personnes soit considérée comme une chose, par exemple comme des insectes dont il faudrait se débarrasser.
Une autre objection contre l’extension vient cette fois des juristes. Il convient de souligner que la notion de personne morale n’a pas le même sens en philosophie et en droit. En philosophie elle désigne une personne physique réellement dotée de libre arbitre et sujet de droit. En droit c’est une fiction lorsque le terme s’applique à un groupe de personnes, un club de belotte, un trust, un village, etc., incluant les éléments matériels avec lesquels composent ses membres. L’objection juridique la plus courante contre l’extension consiste à rappeler que les droits sont corrélatifs des devoirs, et qu’on ne peut attribuer aucun droit à des entités naturelles qui ne remplissent aucun devoir envers nous, contrairement à tel club envisagé comme "personne morale" par exemple.  Si le fleuve Wanganhui (sujet de droit en Nouvelle-Zélande) déborde, il ne réparera pas les dégâts provoqués, car il n’assume aucun devoir envers les populations voisines. Il n’existe ici aucune réciprocité entre droit et devoir. La même objection concerne l’extension de la personnalité juridique aux générations futures : on ne saurait leur attribuer dès maintenant des droits dans la mesure où elles n’existent pas et ne remplissent aucun devoir envers nous. En outre, certains juristes considèrent "la personnalisation" comme une fiction inutile, car on peut atteindre la même finalité pratique sans y recourir : une stricte application des lois, et un éventuel renforcement de la loi pollueur/payeur, suffirait à dissuader les entreprise pollueuses et à assurer la protection de la nature. Contre l’ensemble de ces critiques, une autre lignée de philosophes s’attache à montrer aujourd’hui en quel sens l’extension de la personnalité juridique peut cependant être considérée comme "juste" et parfaitement légitime.
Si le fleuve Wanganhui (sujet de droit en Nouvelle-Zélande) déborde, il ne réparera pas les dégâts provoqués, car il n’assume aucun devoir envers les populations voisines. Il n’existe ici aucune réciprocité entre droit et devoir. La même objection concerne l’extension de la personnalité juridique aux générations futures : on ne saurait leur attribuer dès maintenant des droits dans la mesure où elles n’existent pas et ne remplissent aucun devoir envers nous. En outre, certains juristes considèrent "la personnalisation" comme une fiction inutile, car on peut atteindre la même finalité pratique sans y recourir : une stricte application des lois, et un éventuel renforcement de la loi pollueur/payeur, suffirait à dissuader les entreprise pollueuses et à assurer la protection de la nature. Contre l’ensemble de ces critiques, une autre lignée de philosophes s’attache à montrer aujourd’hui en quel sens l’extension de la personnalité juridique peut cependant être considérée comme "juste" et parfaitement légitime.
2. La justesse de la personnalisation : le concept schopenhauerien du juste et de l’injuste.
L’extension de la personnalité peut paraître "juste" si on définit la justice, avec Schopenhauer, comme la négation ou la réparation d’un tort initial commis envers un être ou un groupe d’êtres dotés d’un "vouloir-vivre", c’est-à-dire d’une tendance à vivre et à poursuivre ses intérêts vitaux sans subir de lésion inutile et évitable. Dans cette optique, mieux on prévient, mieux on répare, et plus vite on répare, plus on est juste : or c’est précisément à cette exigence que pourvoie l’extension de la personnalité. Rémy Poels établit un lien essentiel entre la conception schopenhauerienne de l’injustice et les nouvelles fictions juridiques : à partir du chapitre qu’il a présenté dans l’ouvrage précité, c’est un droit naturel d’inspiration schopenhauerienne, adapté à notre époque, qui se profile et qu’il s’agit de construire en détail.
Reste à examiner la nature des sanctions infligées aux entreprises pollueuses. Il existe une grande différence entre les grosses entreprises qui parviennent à contourner les sanctions en s’arrangeant avec les pouvoirs publics, par exemple en payant la taxe carbone et en investissant une part de leurs bénéfices dans des politiques écologiques, et les petites entreprises, qui, elles, sont lourdement sanctionnées faute de moyens financiers pour contourner les sanctions (cf. l'exemple de la Nouvelle-Zélande).
3. Le point de vue des entreprises : l’injustice comme "déséquilibre".
Certes toutes les entreprises doivent répondre de leurs actions face à des entités naturelles dotées de droits. Cependant, les obligations environnementales ne sont pas partagées équitablement entre tous les acteurs économiques (petites entreprises, grandes entreprises, État, etc.). Cela peut être vécu comme une forme de discrimination légale. Sur cet aspect économique, l’approche de Paul Clavier développée dans le collectif précité mérite d’être prolongée : comment concevoir une répartition plus juste des sanctions ? Ne pourrait-on éviter les sanctions décourageantes qui frappent les petites et moyennes entreprises par une aide à la transition écologique partiellement soutenue financièrement par les pouvoirs publics ?
Telles sont les trois grandes lignes de questionnement de l’enquête dans son état actuel.
Prochaine lettre en juin 2025 -- Vous pouvez également vous inscrire à notre liste de diffusion
© 2025 - Archives Henri-Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine / Université de Strasbourg)