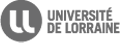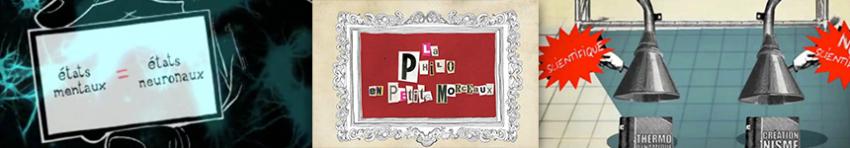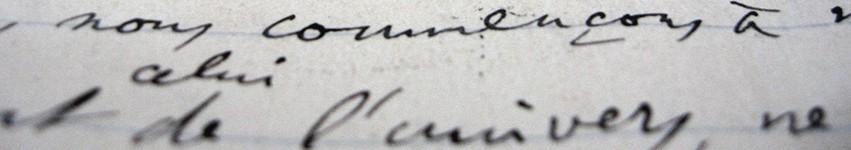Le « tournant pratique » a introduit de nouvelles manières d’étudier les sciences : études « de terrain » (souvent dites « ethnologiques » ou « anthropologiques ») de la science « en train de se faire » ou « en action » ([Latour & Woolgar 1979]) ; études historiques soucieuses de prendre en compte des matériaux jusqu’alors négligés (carnets de laboratoire, brouillons, interviews de praticiens…) et de s’appuyer sur des évaluations quantitatives d’un nouveau genre (bibliométrie) ([Galison 1987] et [Pickering 1984]).
Corrélativement, s’est manifesté un intérêt pour des aspects jusque-là ignorés ou négligés, et de nouveaux objets ont été investigués. On a notamment souligné l’importance des compétences tacites et impossible à expliciter complètement, ainsi que des processus de leur transmission via l’éducation scientifique ou d’une communauté de praticiens à une autre ([Polanyi 1958], [Kuhn 1962], [Stich 1978], [Collins 1974, 1985, 2001a, 2001b], [Davies 1989], [Chomsky 1990], [MacKenzie & Spinardi 1995], [Reber 1995], [Dreyfus 2004]). Sur ce versant, les diverses études existantes semblent converger à propos des points suivants. L’habitude (voire le conditionnement), la fréquentation répétée d’exemples prototypiques et l’analogie jouent un rôle crucial dans l’acquisition et dans l’efficacité des compétences largement tacites qui transforment l’étudiant en professionnel de la discipline. Le modèle de l’artisanat et du compagnonnage est souvent invoqué à la suite de Kuhn et de son idée de paradigmes au sens d’exemples standard. Les compétences acquises mettent en jeu à la fois des normes et des contenus de connaissance (tous deux caractéristiques d’une discipline ou spécialité et qui en définissent l’identité dans un état de la recherche). Elles s’adossent à un espace analogique de similitudes / différences qui rendent le scientifique capable de « voir comme » et de « résoudre comme ». Le caractère communautaire de la science est ainsi mis en avant (les compétences se transmettent par une éducation scientifique relativement standardisée).
On a également voulu « ouvrir la boite noire » des pratiques expérimentales, et l’on s’est employé à caractériser ces pratiques dans leur spécificité, notamment à analyser le processus de constitution des résultats expérimentaux (voir par ex. [Ackermann 1985], [Galison 1987, 1997], [Gooding 1987], [Pickering 1984, 1992]). Ces études ont notamment conduit à mettre au premier plan : l’influence des aspects matériels et de la géométrie du laboratoire (Pickering, Latour, Callon) ; la variété des fonctions de l’investigation expérimentale – pas seulement tester des théories comme traditionnellement ([Gooding, Pinch & Schaffer 1989], [Franklin 1986], travaux de Friedrich Steinle) ; le caractère problématique de la réplication des expériences ([Collins 1984, 1985]) ; les relations entre possibilités de manipuler expérimentalement et jugements d’existence d’entités physiques ([Hacking 1983], [Cartwright 1986]) ; l’intervention de types récurrents de stratégies privilégiées par les praticiens pour établir leurs résultats [Franklin 2009] ; l’existence de variations individuelles et collectives au niveau de ce qui fait figure de preuve expérimentale, et les transformations liées à l’utilisation de plus en plus massive de méthodes computationnelles et de simulations ([Galison 1997], [Pickering 1984]) ; l’importance des procédures de production d’images scientifiques, les caractères spécifiques des résultats « imagés » par rapport à d’autres types de résultats (cf. par exemple [Galison 1997] et les divers travaux de Allamel-Raffin).
On a en outre souligné que l’élaboration purement théorique était aussi une activité pratique mettant en jeu des connaissances tacites et des savoir-faire spécifiques, et comportant des aspects manipulatoires en un sens plus abstrait que des actions physiques sur des objets physiques ([Kuhn 1962], [Galison & Warwick 1998], [Klein 2003]). Les travaux ont d’abord porté sur l’activité théorique et la construction de modèles dans les sciences empiriques, mais le cas de l’activité théorique en mathématiques a aussi, quoique dans une moindre mesure, été considéré ([Kerkhove & Bendegem 2007], [Kitcher 1983], [Maddy 1997], [Mancosu 2008], [Rosental 2003]). Au total, les travaux ont mis l’accent sur les aspects suivants : influence des types d’outils et de supports utilisés par les théoriciens (papier, stylo, schémas, croquis, ordinateurs, images, modèles matériels…) sur l’élaboration et les résultats ([Klein 2001], [De Chadarevian & Hopwood 2004], [Morgan & Morrison 1999]) ; variation des types de raisonnements qui font figure d’argument convaincants dans la sphère ‘purement théorique’ ; caractérisation de l’activité de modélisation ([Morgan & Morrison 1999], [Cartwright N., Shomar T. et Suarez M. 1995]), avec insistance sur l’importance de l’analogie, le rôle de l’éducation scientifique et la nature instrumentale de la modélisation (un modèle pour… tel ou tel but spécifique).
Il a globalement résulté de ces études un déplacement des anciennes questions, l’émergence de nouvelles problématiques et une transformation de tonalité des discours sur les sciences. Pour souligner quelques tendances dominantes : on a conclu à la grande plasticité des pratiques scientifiques, les praticiens pouvant jouer sur de très nombreux facteurs et disposant d’une importante « flexibilité interprétative » ([Collins 1985, 2004] ; [Pickering, 1984, 1995], [Hacking 1992]). On a souligné la variabilité des normes scientifiques dans l’espace et le temps à tous les niveaux. Le caractère « instrumental » de la rationalité scientifique a été mis au premier plan : dans leurs pratiques concrètes quotidiennes les scientifiques s’intéressent plus aux moyens efficaces pour atteindre des buts spécifiques, qu’aux grandes questions ontologiques traditionnellement mises au premier plan par la philosophie des sciences. On a insisté corrélativement sur la diversité et le caractère dépendant-du-contexte des buts et projets mis en jeu ([Teller 2008]). A été revendiqué le rôle constitutif d’éléments négligés, ou jugés anecdotiques car appartenant au « contexte » de la science, par l’épistémologie traditionnelle, tels que la faisabilité concrète à court terme et les paris sur la fécondité future ([Nickles 2008], [Pickering 1995]). Plus généralement, le tournant pratique a conduit à soutenir le rôle constitutif de facteurs traditionnellement relégués du côté du « contexte », de « l’extérieur », de « conditions de possibilités » de la science, ce qui a eu pour effet de remettre en cause l’idée même de la pertinence d’une telle frontière (cf. toutes les discussions autour de l’internalisme / externalisme). La mise au premier plan des facteurs locaux et contextuels a renforcé les positions relativistes et donné lieu à des affirmations disséminées mais nombreuses sur la contingence des résultats ([Soler 2006, 2008, 2009]).