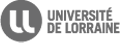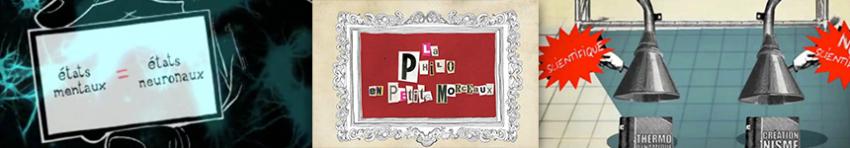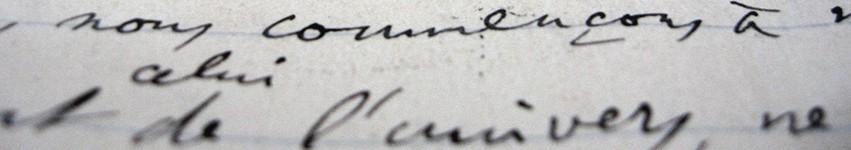De nouvelles difficultés et questions ont surgi, ouvrant des chantiers qui exigent des investigations supplémentaires. En voici des exemples centraux, qui intéressent tout spécialement le projet de recherche, et dont l’investigation constitue ses enjeux.
1. On est encore bien loin de disposer d’une caractérisation satisfaisante de ce qui a été catégorisé comme aspects tacites mobilisés dans les pratiques théoriques et expérimentales ; de plus, les conséquences épistémologiques de l’intervention de tels aspects restent des questions discutées et fortement polémiques.
2. Certains aspects nouveaux, ou qui acquièrent une importance toujours grandissante dans les pratiques scientifiques contemporaines, appellent des réflexions spécifiques. C’est notamment le cas des simulations, sorte d’hybrides entre théorie et expérimentation dont la nature et le statut épistémologique sont problématiques. C’est également le cas des images scientifiques, dont les types sont de plus en plus variés avec la diversité des moyens techniques développés, et dont l’intervention dans une exploration, un argument, une explication ou une présentation scientifiques joue des rôles heuristiques, clarifiants ou probatoires particuliers à examiner de plus près.
3. Une tension irrésolue subsiste entre d’un côté les accents contextualistes et les conclusions relativistes qui se dégagent du tournant pratique, et d’autre part la conviction tenace, difficile à récuser et à laquelle il faut faire droit d’une manière ou d’une autre, de la robustesse des sciences dures, voire de leur universalité. Si certaines propositions prometteuses existent pour résoudre cette tension, notamment les tentatives de W. C. Wimsatt [1981, 2007] pour élaborer un modèle très général de « robustesse », il reste beaucoup à faire pour caractériser les processus et les stratégies par lesquels des accomplissements robustes se constituent dynamiquement au sein des pratiques effectives.
4. Au-delà d’un certain nombre de déclarations disséminées ici et là qui pointent vers la contingence de tel ou tel résultat scientifique, peu d’analyses systématiques ont été conduites sur cette question. Hacking est l’un des rares à en avoir amorcé une ([Hacking 2000]). Mais l’alternative « contingentisme ou inévitabilisme » n’est pas une opposition majeure relativement autonome bien identifiée, alors qu’elle correspond à une (peut-être à la) véritable division de fond au sein des penseurs de la science et est l’un des enjeux cruciaux qui se dégage du « tournant pratique » ([Soler 2008]).
5. La notion même de pratique scientifique requière des élaborations. Dans les pratiques scientifiques effectives, interviennent, entre autres, des ‘théories’ et des présupposés de toutes sortes qui orientent, des normes qui régulent, des buts et des intentions qui fonctionnent comme horizon, des savoir-faire qui constituent, et parfois – pour les pratiques expérimentales tout au moins – des objets matériels qui réagissent… La spécification positive et l’élaboration d’une conceptualisation adéquate des ingrédients susceptibles de constituer les pratiques demeure une tâche cruciale à accomplir. Les propositions existantes restent le plus souvent superficielles et vagues (faisant un large usage du ‘etc.’). Les ingrédients en question sont rarement thématisées et discutées systématiquement en vue d’une taxonomie à prétention générale. Et la compatibilité des diverses propositions n’a rien d’évident (Pour des exemples, voir [Hacking 1992], [Pickering 1995], [Ackermann 1985], [Galison 1987], [Gooding 1989]).
6. Au total, il n’est pas évident de déterminer ce que le « tournant pratique » nous a finalement appris sur les sciences, au-delà de la riche multitude des études de cas particuliers. La recherche d’une perspective d’ensemble qui identifie nettement les acquis, délimite les questions controversées, élabore des outils transversaux et propose autant que possible certaines solutions nouvelles est indispensable.
L’enjeu scientifique du projet est de faire progresser l’investigation de ces différents chantiers interactifs, forts du recul que permettent les quelques décennies de recherches déjà effectuées, en vue de dégager une conception de la science qui, sans prétendre à l’universel, transcende les cas singuliers et capture des traits saillants caractéristiques des pratiques scientifiques et de leurs accomplissements par opposition à d’autres activités humaines, et soit de plus capable d’expliquer comment, et en quel sens, les sciences établissent des résultats robustes et progressent.