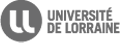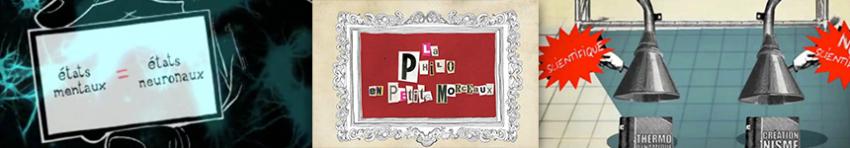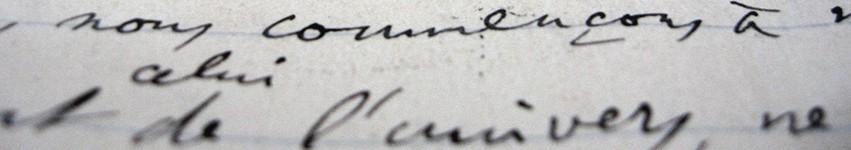Le cycle des Grandes Conférences des Archives Henri Poincaré est conçu comme un espace de rencontre entre chercheurs et grand public.
Il couvre de nombreux champs disciplinaires : philosophie, épistémologie, éthique, histoire des sciences et des techniques, histoire des institutions, sociologie des sciences et des organisations, etc.
Les conférences ont lieu alternativement sur les sites nancéiens et strasbourgeois des Archives Henri Poincaré.
-
Nancy : Campus Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Lorraine, place Godefroy de Bouillon, Nancy, bâtiment A, salle A145, 1er étage ; 2e semestre: bâtiment G, salle G04, rez-de-chaussée
-
Strasbourg : Maison des Sciences de l’Homme, 5, allée du Général Rouvillois, Salle de Conférence
Les conférenciers prévus en 2025-2026 sont, dans l’ordre alphabétique : Raphaël Authier, Thibaud Boncourt, Yacin Hamami, Julie Jebeile, Gaëlle Le Dref, Conor McHugh, David Rabouin.
Les conférences ont lieu de 18 heures à 20 heures à Nancy et de 17 heures à 19h00 à Strasbourg.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Toutes les conférences peuvent être suivies en direct sur internet. Inscrivez-vous ici pour recevoir des informations de connexion avant chaque conférence. Pour plus de détails, écrire à Anna C. Zielinska.
Enregistrement des conférences sur la plateforme vidéo des AHP – cliquez ici & sur notre chaine youtube..
Programme des Grandes Conférences 2025-2026
8 octobre 2025 (à Nancy) | Yacin Hamami (CNRS, Archives Henri Poincaré)
La connaissance collective en mathématiques
Résumé
De Descartes et Kant à Frege et Brouwer, la tradition philosophique a généralement conçu la connaissance mathématique comme le fruit d’une activité solitaire. Pourtant, la pratique réelle montre que la production mathématique est profondément collective : les démonstrations doivent être rendues publiques, soumises à l’examen critique de la communauté et intégrées dans un édifice de résultats qu’aucun individu ne peut maîtriser dans son ensemble. Quelle est alors la nature de la connaissance mathématique lorsqu’on la considère dans sa dimension collective ? Et quels mécanismes assurent la fiabilité et la robustesse de l’édifice mathématique ? Dans cette conférence, nous proposerons quelques éléments de réponse à ces questions.
À partir de plusieurs exemples frappants de dysfonctionnements dans la production de savoir mathématique, nous mettrons en lumière les différentes composantes de la connaissance collective en mathématiques. Nous proposerons alors l’idée que la communauté mathématique fonctionne comme un système multi-agents décentralisé : une architecture collective qui coordonne un grand nombre d’acteurs sans contrôle centralisé, à l’image de certaines formes d’intelligence collective observées en biologie, comme la recherche de nourriture ou la construction de nids dans les colonies de fourmis et de termites. Nous conclurons en soulignant l’intérêt d’étudier le cas des mathématiques pour mieux comprendre la dynamique des savoirs collectifs.
26 novembre 2025 (à Nancy) | Thibaud Boncourt (Université Jean Moulin Lyon 3, membre junior de l’Institut universitaire de France (IUF))
Peut-on faire confiance aux chercheurs ? Les politiques d’intégrité scientifique en France et au Royaume-Uni.
Résumé
Le statut et l’autorité des sciences font l’objet de remises en question dans les sociétés contemporaines, de la part de certaines forces politiques et de citoyens ordinaires. Au fil notamment de scandales de fraudes scientifiques, plusieurs interrogations ont progressivement animé la sphère politique et le débat public : peut-on faire confiance aux scientifiques ? Comment s'assurer qu'ils agissent de manière honnête ? Dans quelle mesure faut-il les surveiller ou les laisser agir à leur guise ? Ces débats ont suscité la mise en place de dispositifs de contrôle de l’intégrité scientifique dans plusieurs pays. Cette conférence se propose de revenir sur l’histoire de ces dispositifs en France et au Royaume-Uni, et de mettre en évidence ce qu’ils nous disent des transformations du contrat qui unit la science et la société.
3 décembre 2025 (à Strasbourg) | Gaëlle Le Dref (CNRS, Archives Henri Poincaré)
Entre impératifs de santé publique, déontologie médicale et contraintes sociotechniques, quelle éthique pour les médecins généralistes en France ?
Résumé
En France, le médecin généraliste est institutionnellement au cœur du système de soins en même temps que de nombreux dispositifs de santé publique. En pratique, ainsi que l’exprime une ample littérature en sociologie, santé publique et anthropologie, les médecins généralistes peinent à répondre tant aux attentes des institutions de santé publique que des patients, en même temps qu’ils s’estiment socialement dévalorisés. Il s’avère en effet que l’exercice quotidien de leur métier est rendu complexe par des obligations et contraintes qui peuvent entrer en contradiction les unes avec les autres. Les injonctions de santé publique peuvent ainsi s’opposer à ce qu’ils estiment être de leur devoir tant du point de vue de la déontologie médicale que des besoins et attentes des patients, le tout dans un contexte de pénurie de l’offre médicale. Mais comment les médecins généralistes parviennent-ils en pratique à répondre à l’ensemble de leurs obligations ? Comment concilient-ils leur devoir de soin et de sollicitude envers chaque patient, avec toutes leurs particularités et leurs souffrances les plus immédiates, et ce que la santé publique requiert d’eux au nom d’un objectif de santé collective à long terme ?
Ma communication présentera le projet de recherche que je souhaite mener au cours de ces prochaines années et qui a pour objectif, grâce à une méthodologie relevant de la philosophie de terrain, la mise en évidence et la compréhension des pratiques et convictions éthiques actuelles des médecins généralistes. Dans un premier temps, à l’aide d’une revue de littérature, je rendrai compte des difficultés que rencontrent les médecins généralistes et des processus par lesquels ils se trouvent a priori dans une forme d’inconfort éthique dans le quotidien de leur pratique. Puis, j’exposerai les études de cas que j’envisage de réaliser, à savoir, la prescription médicamenteuse, la téléconsultation et le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, ces cas me semblant constituer des situations exemplaires de cet inconfort.
4 février 2026 (à Strasbourg) | Raphaël Authier (Université de Strasbourg, Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine (CRePhAC))
L'idéalisme allemand : newtonien, anti-newtonien, post-newtonien ?
Résumé
À venir.
18 mars 2026 (à Nancy) | David Rabouin (CNRS, laboratoire SPHERE)
Éditer les manuscrits mathématiques de Leibniz : défis et résultats
Résumé
À venir.
1 avril 2026 (à Strasbourg) | Julie Jebeile (Universität Bern, Suisse)
Quelles innovations technologiques face au changement climatique ?
Résumé
À venir.
6 mai 2026 (à Nancy) | Conor McHugh (Université de Lorraine, Archives Henri Poincaré)
Actions as attitudes
Résumé
À venir.
- - -
Programme des années précédentes : 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025